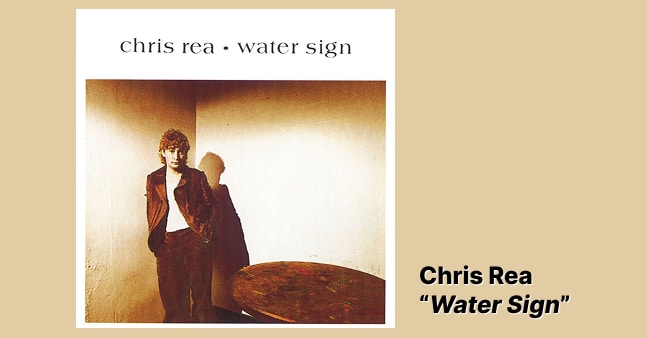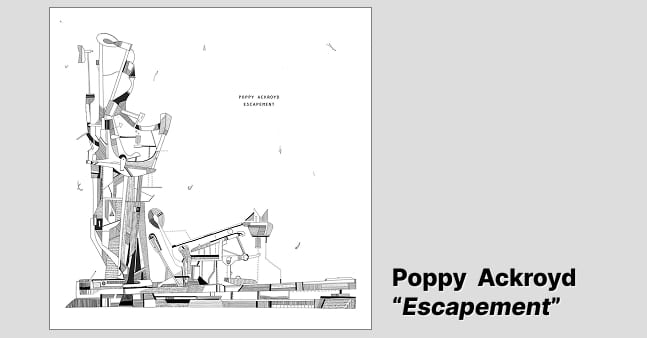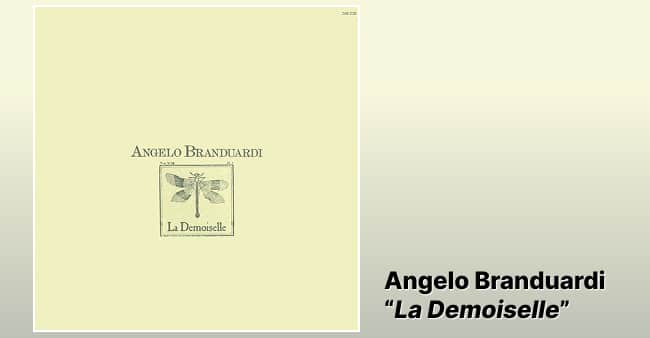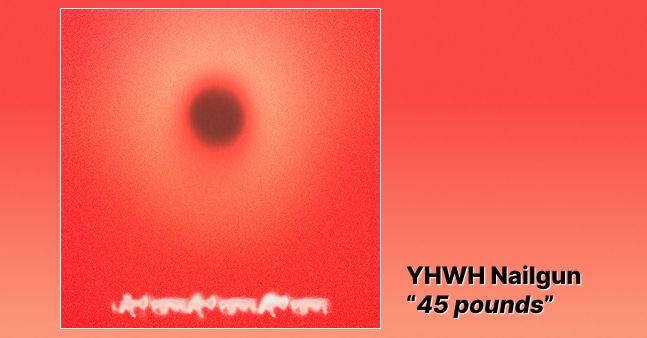Cass McCombs, carnet ouvert

Avec “Interior Live Oak“, l’Américain ne publie pas tant un album qu’il n’ouvre un carnet. Pages intimes, routes prises trop vite, mythes réduits à l’état de notes : un disque écrit à voix basse, qui préfère laisser des traces plutôt que construire un récit.
Certains artistes qui ne s’annoncent pas. Ils ne frappent pas à la porte, ne réclament pas l’attention : ils attendent qu’on soit prêt à les lire. Cass McCombs est de ceux-là. Longtemps, il a été pour moi un nom respecté, jamais vraiment habité, une silhouette discrète dans l’arrière-plan de l’indie américain. Et puis, presque par accident, je me suis retrouvé à fouiller découvrir “I Went to the Hospital” sur l’album “A“ : Deux minutes. Une phrase. Pas une confession, plutôt un constat : je suis allé à l’hôpital, j’étais malade de ma vie. Comme une note griffonnée, laissée sur la table avant de sortir, sans être sûr de revenir. À cet instant, on comprend que McCombs écrit comme on note pour soi — et que tout son travail procède de ce geste-là.
“Interior Live Oak” s’inscrit exactement dans cette continuité : un disque qui s’écrit sous nos yeux.Très vite pourtant, il se met en mouvement. Pas une grande traversée mythologique, plutôt une route secondaire prise trop vite. Sur “Who Removed the Cellar Door?“, le moteur ronfle, obstiné, légèrement dangereux. La batterie insiste, la guitare tourne en boucle, le morceau avance sans chercher à convaincre. On sent le bitume, la vibration continue. La “cellar door” retirée -ce plancher qui manque, ce dessous qu’on ne veut pas voir, devient une menace abstraite. McCombs ne descend pas à la cave : il accélère. La fuite en avant devient une forme de lucidité.
Puis, sans prévenir, le disque se replie sur lui-même. Avec “I Never Dream About Trains“, McCombs cesse de composer pour ouvrir son carnet. On entend presque le froissement du papier. Le piano éclaire à peine, la voix lit plus qu’elle ne chante. Ne jamais rêver de trains : phrase plate, presque administrative, qui retire d’un coup tout le folklore américain du départ et du destin. Ce n’est plus de la mise en scène, mais une pensée laissée intacte. Le disque devient troublant parce qu’il ne cherche plus à être écouté : il se dépose.
Après ce cœur intime, le monde extérieur revient par effraction. “Lola Montez Danced the Spider Dance” charrie de la poussière, des figures mythiques, un Sud-Ouest fantasmé. Difficile de ne pas penser à Calexico : même lenteur processionnelle, même cinéma sans images. Mais McCombs refuse l’exotisme. La danse est étrange, presque inquiétante, vue de biais. Un mythe réduit à l’état de vision nocturne, fragmentaire, noté plus que raconté.
La fin, elle, ne conclut rien : elle enracine. Le morceau-titre, “Interior Live Oak“, adopte un grain plus rugueux, presque blues-rock. Un instant, on pense à The Black Keys : le bois, la terre, la répétition qui tient. Mais ici, aucun effet. Le live oak, chêne du Sud capable de survivre aux tempêtes, devient une image finale volontairement anti-lyrique. Pas de révélation. Juste ce qui reste. “Interior Live Oak” -l’album, n’explique rien, ne démontre rien. C’est un disque qui note, qui laisse des traces de passage : routes prises trop vite, phrases écrites sans relecture, mythes fatigués, racines plantées sans emphase. Cass McCombs n’y construit pas un récit : il ouvre son carnet, et nous laisse regarder par dessus son épaule. C’est un album à lire, comme on lit Twain, Jack London ou Jack Kerouac.
★★★★☆
Cass McCombs “Interior Live Oak” (Domino Rec), 2025