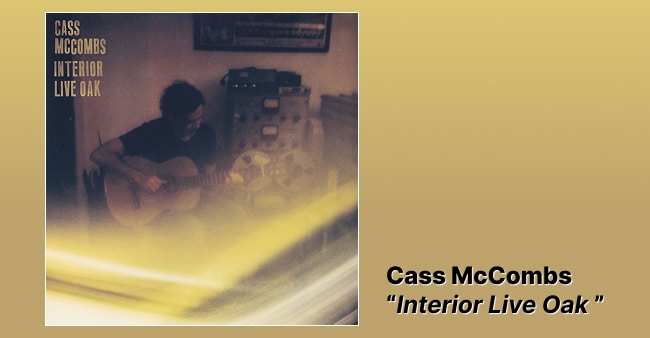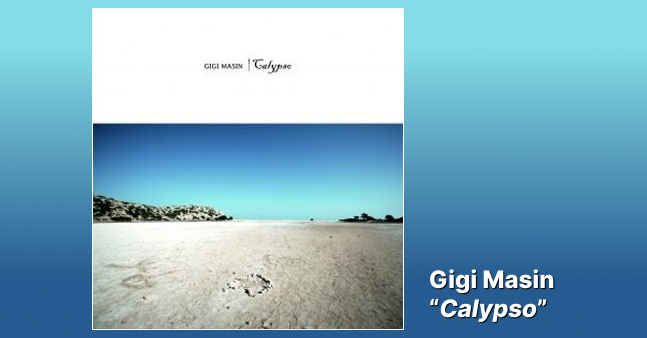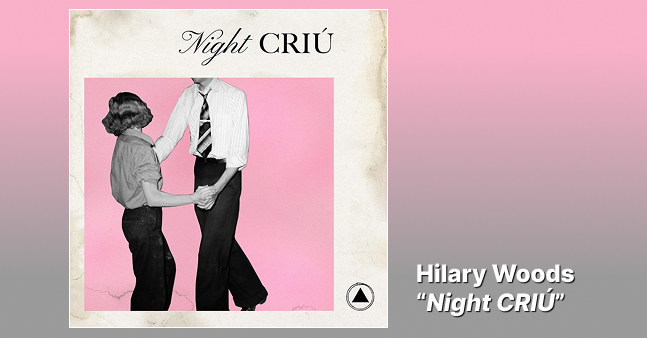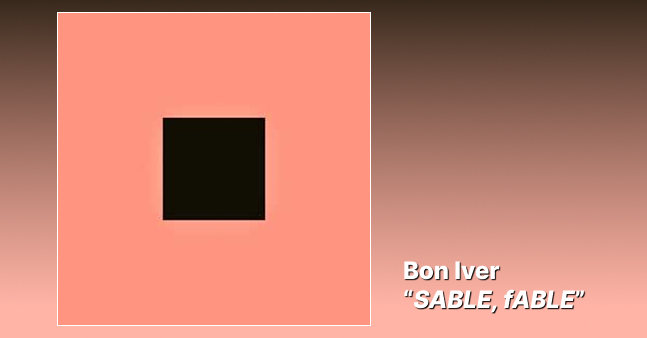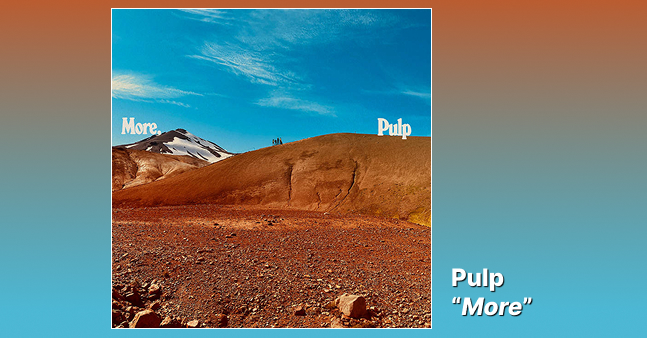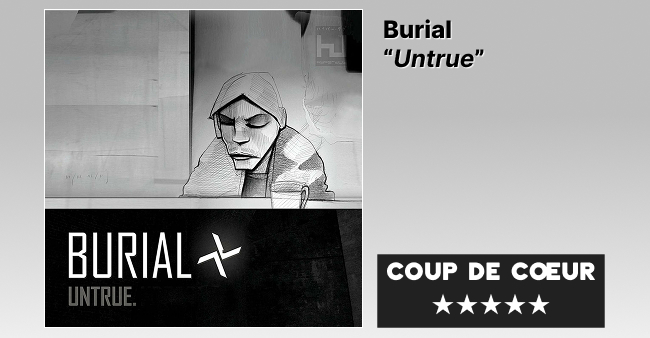Rosalia renoue avec le sacré

Le sacré mais pas les dogmes : celui qu’on fabrique soi-même, à la force du doute et de la vision. Avec LUX, enregistré avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Daníel Bjarnason et qu’elle produit elle-même, elle ne signe pas seulement un album ambitieux — elle impose un nouvel espace, quelque part entre opéra, liturgie et pop expérimentale.
La rupture avec “Motomami” est totale : plus de fragmentation numérique, plus de provocations pop, mais un geste ample, orchestral, vertical, nourri de mysticisme et d’une recherche intérieure qui dépasse la simple idée d’évolution artistique. “LUX” est conçu comme une œuvre en quatre mouvements, pensée avec la même rigueur qu’une pièce contemporaine, mais habitée par une intuition éminemment pop : celle qui fait circuler l’émotion avant le concept.
L’universalité recherchée traverse l’album de part en part : Rosalía chante en quatorze langues – catalan, espagnol, latin, italien, portugais, japonais, mandarin, arabe, allemand, hébreu, ukrainien, français, sicilien… Ce n’est pas une démonstration polyglotte, mais une manière de tisser une lumière plurielle, de s’arracher aux frontières stylistiques qu’on lui colle depuis le début de sa carrière. Le disque convoque autant Hildegard von Bingen que la mystique soufie, des prières féminines médiévales jusqu’aux chants d’amour les plus terrestres. C’est là que réside la réussite : “LUX” n’illustre pas la spiritualité, il l’habite. Rosalía ne joue pas la prêtresse, elle joue l’être humain traversé par la transcendance, et la transcendance traversée par le bruit du monde.
Dans cette cathédrale de cordes, de chœurs et d’électronics ténues, les collaborations – Björk, Yves Tumor, Carminho, Yahritza y Su Esencia, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, ne sont pas des apparitions décoratives, mais des voix-totems qui amplifient le geste. La présence de Björk, notamment, achève d’ancrer Rosalía du côté des artistes qui défient la forme plutôt que de s’y lover. Le single “Berghain” a immédiatement donné la direction : un morceau en allemand et espagnol, pris entre techno fantôme et composition chorale, illustré par un film de Nicolas Méndez où Rosalía chante au milieu d’un orchestre dans des lieux ordinaires — comme si la lumière, la vraie, devait être cherchée dans ce qui nous entoure, et non dans un horizon mythifié.
Ce qui frappe surtout, c’est le sérieux du geste. Depuis un moment, Rosalía répète qu’elle cherche à s’éloigner de la dopamine, de l’immédiateté, du réflexe. “LUX” met cela en acte : l’album refuse la gratification instantanée, refuse la pop jetable, refuse le clinquant. C’est un disque qui demande une écoute lente, une attention totale, presque une posture. Mais ce refus du confort n’est jamais arrogant : il traduit une vulnérabilité nouvelle, une forme d’humilité face au colossal — l’amour, la foi, la perte, le doute. Et le public l’a reçu sans peur : “LUX” a explosé les compteurs avec plus de 42 millions de streams Spotify en 24 heures, record pour une artiste hispanophone. C’est la preuve que la radicalité peut toucher au cœur, dès lors qu’elle est sincère.
Dans “LUX“, il y a de la douleur, du désir, des prières, des incantations, des éclats d’obscurité et de lumière. Rosalía n’y joue pas la sainte, mais la pèlerine – celle qui traverse, cherche, trébuche, recommence. La lumière dont il est question n’est jamais pure : elle est cabossée, fêlée, humaine. Et c’est précisément parce qu’elle ne cherche pas à « élever » la pop, mais à l’ouvrir vers un champ spirituel et émotionnel plus vaste, que “LUX” devient un acte rare. Un disque qui ne brille pas : il brûle. Et dans le paysage actuel, cette brûlure a quelque chose de profondément nécessaire.
★★★★☆