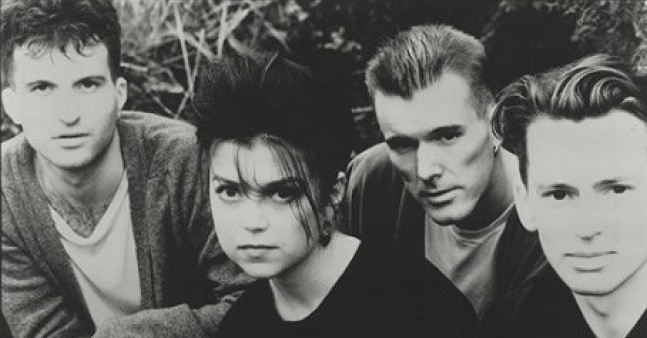Cabaret Voltaire : anatomie d’un laboratoire sonore

A l’occasion de leur venue à Paris-L’Elysée Montmartre en le 5 juin 2026 (voir les infos), on rembobine l’histoire de Cabaret Voltaire, un qui ne se contente pas d’écrire des chansons mais a inventé des langages. Des groupes dont la trajectoire ne se lit pas en ligne droite, mais en éclats : fragments d’expérimentation, tensions politiques, bricolages sonores et coups d’éclat électroniques. Cabaret Voltaire fait partie de ceux-là. Groupe-phare de la musique industrielle, puis de l’électro avant l’heure. À travers collages sonores, manipulations de bandes et pulsations mécaniques, Cabaret Voltaire n’a cessé d’expérimenter, influençant une lignée entière d’artistes, de Nine Inch Nails à Aphex Twin.
Réunis en 1973 dans la grisaille de Sheffield, les trois comparses – Richard H. Kirk, Stephen Mallinder, Chris Watson, ont fait de l’atelier leur scène, du magnétophone leur instrument, de la ville ouvrière en déclin leur décor mental. Le nom qu’ils empruntent au cabaret dadaïste n’est pas un clin d’œil : c’est un programme. Déstructurer, déranger, détourner. Faire de la musique une surface instable, un territoire politique, un théâtre de dissonances.
Entre 1979 et 1984, Cabaret Voltaire publie une suite de disques qui transforment le post-punk en laboratoire électronique et font du chaos un matériau artistique. Retour sur les jalons essentiels.
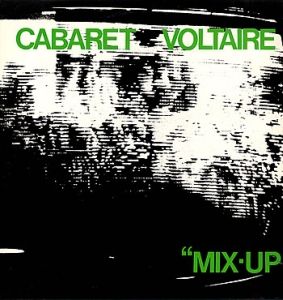
“Mix-Up” (1979) : le manifeste des bricoleurs de l’ère industrielle
Premier album, première secousse, qui dit mieux ? “Mix-Up” ne cherche pas à séduire, ça c’est pour les mauviettes, non, il cherche à déstabiliser. On y entend tout ce que Cabaret Voltaire possède alors d’essentiel : la fascination pour les bandes magnétiques trafiquées, l’esthétique brute de décoffrage, l’obsession du rythme cassé et des bruits environnants. Le groupe enregistre comme on ferait un collage dada : sans hiérarchie, sans pudeur, sans politesse, remonte ton slibard Lothar. Le résultat respire la cave humide, les câbles usés, les fréquences mal maîtrisées. C’est un album, oui, mais c’est plutôt un chantier et c’est précisément ce qui le rend irremplaçable. Les morceaux oscillent entre proto-indus (le martèlement de “Kneel to the Boss”), happenings sonores (“Photophobia“), et longues dérives électroniques encore maladroites mais étrangement visionnaires. On y devine déjà le futur : les machines qui prennent le pouvoir, la voix qui devient texture, et cette volonté farouche de faire danser autrement… ou de ne pas faire danser du tout.
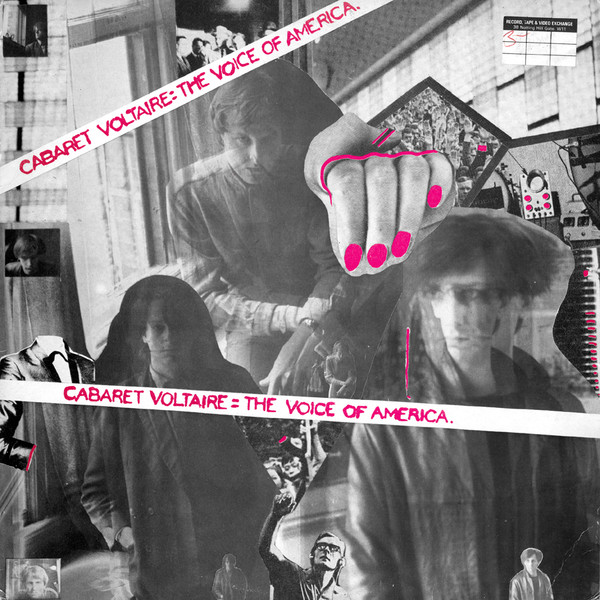
“The Voice of America” (1980) : radio, paranoïa et politique
Avec “The Voice of America“, Cabaret Voltaire trouve sa colonne vertébrale. Les percussions se resserrent, les montages s’affinent, les nappes s’épaississent. Le groupe s’intéresse au flot médiatique, aux voix qui saturent l’espace public, à la propagande douce qui envahit les foyers. Ce titre, emprunté à la radio d’État américaine, n’est pas choisi au hasard : il s’agit d’un disque sur la manipulation — sonore, politique, psychologique. Le son reste brut mais devient lisible : un pulsing nerveux, des synthés granuleux, des échos qui claquent. Les morceaux paraissent taillés dans de la tôle. La voix, elle, n’a plus rien de lyrique : elle déclame, commente, murmure. La musique fonctionne comme un reportage fantôme d’un monde en pleine mutation conservatrice. On est encore dans l’expérimental, mais le laboratoire s’organise. Cabaret Voltaire a trouvé sa méthode : décomposer le réel pour en révéler les tensions.

“Red Mecca” (1981) : une liturgie électronique pour temps troublés
“Red Mecca” n’est pas qu’un disque : c’est une pièce d’atmosphère. Une chambre noire. Une paranoïa douce qui infuse lentement. Publié en pleine montée des tensions entre blocs Est et Ouest, l’album résonne comme une chronique dystopique de son époque — sans jamais prononcer un seul mot politique. Musicalement, c’est une alchimie. Tout y est plus dense : les orgues synthétiques, les lignes de basse sombres, les motifs répétitifs qui tournent comme des pensées obsédantes. Les morceaux s’étirent, construits autour d’un groove lent, presque religieux. Cet album n’a rien de spectaculaire : c’est une infiltration. Il se glisse dans la nuque, trouble les repères, installe une tension qui ne lâche jamais. Jamais Cabaret Voltaire n’aura semblé aussi cohérent, aussi habité. C’est ici que le groupe devient un monument discret mais incontournable de la musique industrielle — celle qui préfère suggérer plutôt que marteler.
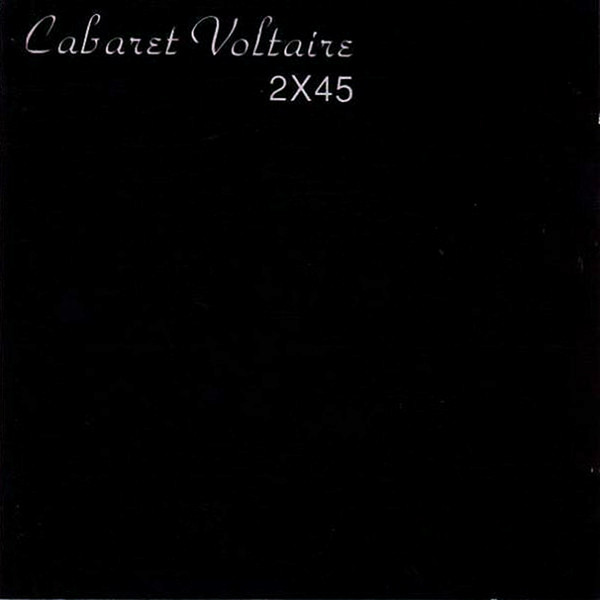
“2×45” (1982) : quand l’indus découvre le mouvement
Compilation de deux EPs publiés séparément, “2×45” est un disque souvent oublié des néophytes, et pourtant crucial. Plus organique, plus physique, il fait la jonction entre l’indus paranoïaque de la première période et la mutation dansante à venir. Les rythmiques deviennent plus nettes, plus circulaires ; les instruments traditionnels (guitares, basse) retrouvent un rôle moteur. On sent la transition : Chris Watson quitte le navire, les influences funk et dub s’invitent par la petite porte, et l’idée de plier ces bricolages vers des structures club commence à émerger. C’est un disque de seuil, vibrant, presque fiévreux.
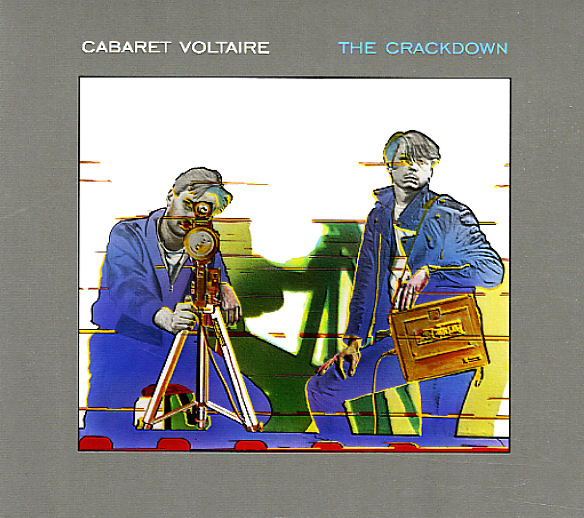
“The Crackdown” (1983) : l’épure synthétique : la nuit entre dans la machine
Nouvelle maison de disques, nouveaux moyens, nouveau son : “The Crackdown” marque l’entrée de Cabaret Voltaire dans la modernité électronique. Le trio devient duo (Kirk/Mallinder), les machines prennent de l’assurance, les morceaux gagnent en précision ce qu’ils perdent en chaos. La musique n’est plus un collage : c’est une architecture. Les basses sont profondes, les boîtes à rythmes claquent, les synthétiseurs dessinent un paysage urbain, nocturne, impeccablement maîtrisé. Le ton reste sombre, mais quelque chose pulse désormais de façon irrésistible. La dance music -celle des clubs obscurs, moites, en sous-sol, n’est plus très loin.
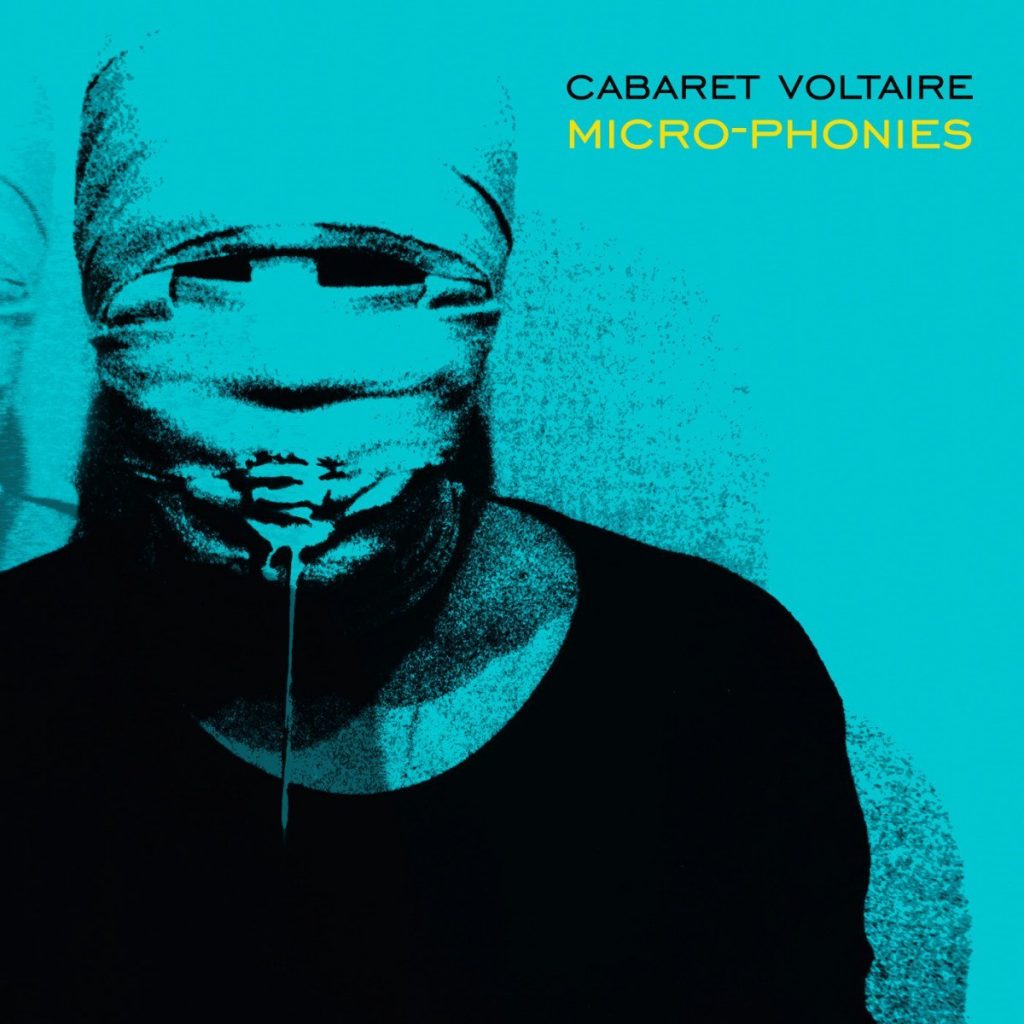
“Micro-Phonies” (1984) : la rencontre entre l’avant-garde et la pop noire
Ici, Cabaret Voltaire ose un geste rare : s’avancer vers le public sans renier son ADN expérimental. Le single “Sensoria“, accompagné d’un clip marquant, devient un classique de la culture underground et démontre qu’un groupe industriel peut, sans se travestir, atteindre une forme de visibilité. Le son est plus lumineux, ou plutôt mieux éclairé : moins de brouillard, plus de lignes nettes. Les rythmes flirtent avec l’electro-funk, les structures s’arrondissent, les mélodies émergent timidement. Mais l’inquiétude demeure, toujours tapie dans les angles morts. L’album n’abandonne jamais l’obsession de la répétition hypnotique, cette manière unique de transformer la machine en rituel. “Micro-Phonies” devient ainsi un pont : entre les ombres et la lumière, entre le laboratoire et le dancefloor.
Cabaret Voltaire part du collage bruitiste et de l’anti-chant (fin seventies), atteint une apogée sombre et politique (“Red Mecca“), puis opère une transition vers des formes plus dansantes et accessibles (“The Crackdown“, “Micro-Phonies“) sans renier son côté avant-gardiste. La mort (en 2021) de Richard H. Kirk a clos une trajectoire qui a durablement façonné l’électronique et l’indus.